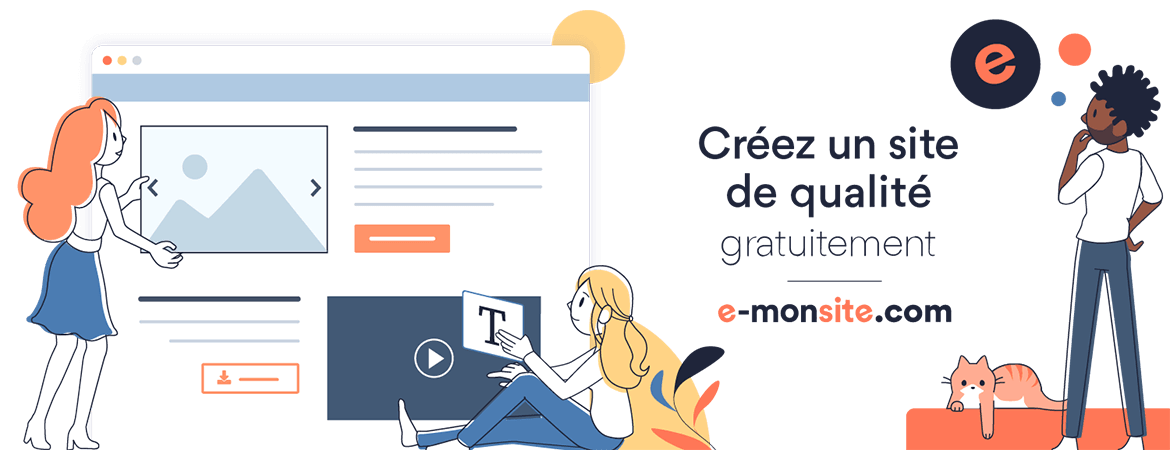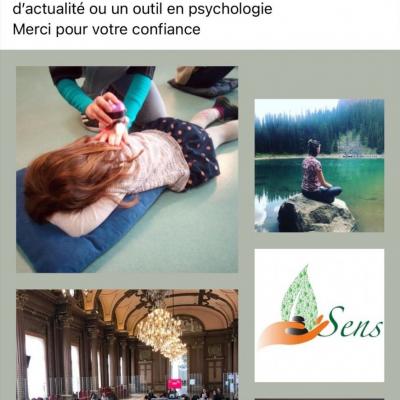Comment motiver mon enfant envers son travail scolaire?
- Par sens-savoiretre
- Le 12/05/2020
--> SOUTENIR SON AUTONOMIE ET SA MOTIVATION
Grolnick (2003) définit « le soutien à l'autonomie » comme un contexte offrant la possibilité de choisir, minimisant différentes formes de pression et encourageant l'initiation de l'action chez la personne concernée, plus précisément ici de l’enfant en situation d’apprentissage (cité par Courtemanche-Brochu, 2007). Cinq comportements ont été définis dans la littérature comme soutenant l’autonomie et la motivation : le fait d’identifier et de nourrir les motivations internes, de donner des choix véritables à l’enfant, d’utiliser un langage flexible aidant l’enfant à diagnostiquer et résoudre ses problèmes, d’utiliser un langage informationnel ainsi que de faire preuve d’empathie (Sarrazin et al, 2011).
Tous ces comportements sont favorisés par l’implication des parents dans l’éducation scolaire de leur enfant (Grolnick et Ryan, 1989). Cette implication nécessite qu’ils connaissent les caractéristiques de leurs enfants (physique et psychiques de leur enfant) ainsi que leurs préférences. Elle implique également le temps passé sur les devoirs scolaires ou encore sur la manière dont les échanges sont effectués durant ce temps de travail entre le parent et son enfant (Grolnick et Ryan, 1989).
Motiver et rendre actif son enfant dans le travail scolaire:
Afin de motiver les enfants envers leur apprentissage, il est nécessaire pour les parents d’identifier et de nourrir la motivation interne de leur enfant. Ceci signifie qu’il faut favoriser les initiatives et les choix des enfants en fonction de leurs intérêts ponctuels (Sarrazin et al., 2011). En effet, l’utilisation des verbes de « contrôle » tel que le verbe « devoir » (ex. il faut, tu devrais...) mais aussi l’utilisation des questions directives (ex. tu as révisé tes cours ?) n’encouragent pas l’enfant à travailler, ni sa motivation intrinsèque (Grolnick, 2009). Il est préférable de favoriser la leçon du jour en fonction des intérêts manifestés par l’enfant, ce qui s’appuie sur les connaissances que les parents ont de leur enfant (ex. préférence, facilité) (Sarrazin et al, 2011).
De plus, Grolnick et Ryan (1989) ajoute l’importance des aspects de non-directivité des parents où ces derniers sont invités à inclure l'enfant dans les décisions et la résolution des problèmes, au lieu d'imposer leur agenda et ne pas laisser libre choix à leur enfant. Dans cadre, le parent évitera de dire « aujourd’hui, on fait ça ou ça ? » mais pourra plutôt favoriser les choix qui répondent à un intérêt pour l’enfant : « tu voudrais travailler quelle matière aujourd’hui ? ah les mathématiques ! bonne idée !» (Sarrazin et al, 2011). Ainsi, l’enfant éprouvera un sentiment plus important d’autonomie (Sarrazin et al., 2011) et se sentira comme acteur principal (agent) concernant l'école mais aussi dans d’autres domaines (Grolnick, 2009).
Utiliser un langage flexible et aidant à la résolution de problème:
Il est également important que les parents utilisent lors du travail académique, un langage flexible et informationnel envers leur enfant. En effet, parfois l’enfant sera face à des activités jugées comme inintéressantes et amotivantes. Lors de la réalisation d’une tâche non motivante pour l’enfant (ex- apprendre ses tables de mathématiques), le parent peut expliquer l’importance et l’utilité de la tâche ainsi que le besoin auquel elle répond en énonçant par exemple « c’est important d’apprendre les tables de mathématiques car cela te permet de calculer ton argent lorsque tu veux acheter de nouveaux jeux/bonbons ». En fournissant des explications rationnelles, les parents favorisent l’acceptation de la réalisation de l’activité et ses règles. L’enfant comprendra également le pourquoi il investit du temps et de l’énergie dans la tâche concernée (Sarrazin et al., 2011).
De plus, lors d’une activité scolaire, l’enfant peut faire des erreurs et ce, d’autant plus si la tâche n’est pas jugée comme intéressante. Dans ce cadre, deux choses primordiales interviennent dans la relation parent-enfant. Tout d’abord, la connaissance des compétences ou difficultés des enfants dans une tâche par les parents, puis l’utilisation d’un langage flexible aidant l’enfant à comprendre et résoudre ses problèmes. Il sera préférable d’énoncer « tu t’es trompé, sais-tu pourquoi » puis que le parent mette en évidence les éléments saillant aidant à la compréhension et à la résolution du problème « regarde, dans la consigne, le professeur à utiliser tel verbe, on pourrait souligner ensemble les mots importants ? ».
Etre à l'écoute de son enfant
Tous ces échanges qui ont lieu dans, les activités académiques sont enrichies par les capacités d’empathie. Ainsi, lors d’une tâche non motivante ou difficile à réaliser, l’enfant peut montrer des résistances ou des difficultés (ex- “je ne veux pas apprendre ça, j’aime pas”). Dans ce cadre, le style soutenant l’autonomie implique que les parents entendent de façon bienveillante les refus de l’enfant et les considère comme des réactions acceptables (Sarrazzin et al., 2011).
De plus, si l’enfant ne complète plus ses devoirs et ne veut pas les réaliser, le parent peut « lui laisser savoir qu'il n'a pas à terminer tout son travail maintenant et voir s’ils peuvent l'aider à trouver la cause de sa lassitude. » (très soutenant) ou « lui laisser savoir comment il se compare aux autres élèves quant à ses devoirs et l'encourager à rattraper les autres. » (Modérément soutenant) (Courtemanche-Brochu, 2007).
autonomie et motivation de son enfant envers les devoirs/travail scolaire site internet question du jour article blog